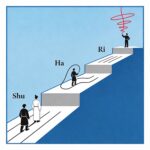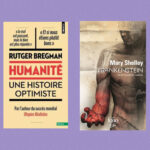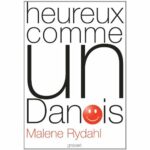« Si tu mènes ton équipe à la carotte et au baton, t’étonnes pas d’avoir des ânes. »
On oppose souvent l’autorité et la bienveillance en management, comme si la fermeté était une question de force et la bienveillance, une question de douceur ou, pire, de faiblesse. Pourtant, les recherches académiques, comme les retours terrain, convergent : prendre le parti de la bienveillance n’est jamais un choix « facile »—c’est un acte de courage, bien plus exigeant, qui confronte chaque manager à son humanité et à sa vulnérabilité.
Le courage managérial : refuser la fuite et l’autoritarisme
Philosophes et coachs s’accordent : « Il n’existe pas de courage managérial sans bienveillance et intérêt porté à l’autre »[1]. Être courageux, c’est assumer sa vulnérabilité, affronter les véritables enjeux : dire les choses (même les plus difficiles), accompagner la progression sans complaisance, et oser instaurer une qualité de relation qui ne repose pas uniquement sur le pouvoir du statut, mais sur la légitimité humaine construite dans l’écoute, la clarté et le respect[1][2].
La bienveillance n’est pas le laisser-faire. Elle amène à affronter les situations complexes, à recadrer sans blesser, à protéger ses équipes — et non à éviter le conflit. Philippe Boyer le résume : « Un manager bienveillant est quelqu’un qui dit les choses, qui ne laisse pas une situation se dégrader. Il sait faire preuve de courage pour aider ses collaborateurs à progresser. »[2]
Pourquoi la posture autoritaire est, paradoxalement, la plus facile— et ses limites profondes
L’autoritarisme managérial s’appuie sur le pouvoir hiérarchique, la rigidité des règles, et la prise de décisions unilatérales. Son efficacité apparente tient à sa simplicité : il ne requiert ni dialogue, ni remise en question personnelle, ni attention particulière aux besoins ou ressentis de l’équipe. Instaurer l’autorité par l’ordre et la sanction, c’est choisir le raccourci du contrôle : la relation verticale, l’évitement du conflit par la peur, le refus du débat.
Pour le manager, c’est souvent la voie la plus rassurante. Elle permet d’obtenir rapidement l’obéissance et d’éviter l’exposition émotionnelle. Cette démarche repose sur un scénario où le dirigeant ne s’implique pas dans l’écoute, refuse l’incertitude inhérente au collectif, et conserve ainsi une forme d’invulnérabilité factice. Selon les recherches en psychologie du travail, ce modèle génère moins de stress pour le manager à court terme, puisque toute complexité humaine est ignorée ou jugulée par la contrainte.
Mais cet apparent « confort » a un coût :
- Il crée de la distance et inhibe l’initiative : les collaborateurs n’osent pas proposer, se contentent d’exécuter, et l’engagement s’érode.
- La peur du blâme ou du rejet bloque la créativité et la prise de risque, deux moteurs essentiels de la performance à long terme.
- Les conflits latents ne sont pas résolus mais enfouis, et ressurgissent sous forme de démotivation, turnover ou résistance passive.
- Le manager autoritaire se prive de l’intelligence collective, faute de dialogue et d’écoute authentique.
Des études (Karakas & Sarigollu, 2012 ; Harvard Business School, 2025) montrent que si l’autorité pure paraît efficace pour gérer l’urgence ou la crise ponctuelle, elle est contre-productive pour la résolution des problèmes complexes, la fidélisation des talents et la transformation des organisations. L’autorité simplifie à l’excès ; or, le réel du management moderne réclame nuance, adaptation, et capacité à naviguer l’ambiguïté.
En définitive, la posture autoritaire protège le manager… mais lui interdit, à lui comme à son équipe, d’atteindre le plein potentiel humain et collectif. Elle donne l’illusion du contrôle, mais en réalité, elle fragilise la dynamique de confiance et la capacité d’innovation.
La bienveillance : entre exigence et vulnérabilité
Le management bienveillant réclame :
- d’assumer ses propres émotions et zones d’incertitude ;
- d’effectuer des recadrages sans brutalité mais sans esquive ;
- de dire non, de poser des limites, de réparer sans humilier ;
- d’accepter que l’on n’ait pas toujours raison et que l’on doive continuer d’apprendre dans la relation à l’autre[1][2][3][5].
Cette posture suppose une connaissance de soi exigeante et une capacité à faire respecter le cadre en incarnant LE double mouvement : soutien & clarté dans les attentes, écoute & exigence, permission & protection. Cela demande d’affronter ses propres peurs (peur de déplaire, d’être contesté, de lâcher du contrôle)[1][5].
Ce qu’en disent les études scientifiques
- Une synthèse des recherches sur le leadership bienveillant montre que ce type de posture managériale requiert une conscience de soi accrue, une forte capacité d’humilité et de remise en question, ainsi qu’un vrai courage pour affronter les décisions difficiles et assumer l’échec collectif plutôt que de faire porter la faute aux équipes[6][7].
- Des travaux récents (Harvard Business School, 2025) montrent que les équipes dirigées par des managers courageux et bienveillants sont 15% plus productives que la moyenne, tout en maintenant un niveau d’engagement et de confiance nettement supérieur[8].
- Karakas & Sarigollu (2012) ont défini le leadership bienveillant comme un processus fondé sur l’éthique, la création de sens, la prise de décision courageuse et le soutien à la progression individuelle. Ces dimensions supposent un surcroît d’effort et d’introspection que n’exige pas l’exercice du seul pouvoir[6].
- Les retours d’expérience en entreprise montrent que le courage managérial n’est jamais acquis : il se travaille, se cultive, et requiert de s’exposer volontairement aux doutes, à la critique, et à la nécessité d’incarner soi-même ce que l’on attend des autres[9].
La bienveillance, un outil de management exigeant
Choisir la bienveillance en management, c’est choisir chaque jour la voie la plus ardue : celle du risque relationnel, du développement de l’autre, de la confrontation responsabilisante—là où l’autoritarisme ne demande que la répétition du même. C’est précisément ce supplément de courage qui fait toute la différence : pas seulement pour la santé des équipes, mais pour la croissance humaine, l’engagement et la réussite collective à long terme.
Il faut infiniment plus de courage pour être, jour après jour, un manager bienveillant-exigeant — qu’un chef autoritariste. Parce que la bienveillance confronte sans jamais écraser, protège sans asphyxier, et accompagne sans jamais s’abdiquer soi-même.
Sources
Principales références scientifiques et universitaires utilisées :
- Karakas, F. & Sarigollu, E. (2012). “Benevolent Leadership: Conceptualization and Construct Development,” Journal of Business Ethics.
- Harvard Business School (2025), https://www.hbrfrance.fr/leadership/pour-impulser-le-changement-le-leadership-est-plus-important-que-lautorite-60135
- Synthèses et observations issues de conférences AIMS, 2024[6].
- Analyses et articles professionnels :
- [1] LE COURAGE MANAGERIAL | Comment affirmer son … https://www.adhemis.com/article/post/le-courage-managerial-ou-comment-affirmer-son-exigence-dans-un-cadre-de-bienveillance
- [2] Bienveillance & Exigence, une injonction contradictoire https://www.fasterclass.fr/blog/post/culture-manageriale-bienveillance-exigence-une-injonction-contradictoire
- [3] Comment renforcer son « courage managérial » – Capital.fr https://www.capital.fr/votre-carriere/comment-renforcer-son-courage-managerial-1369338
- [4] Qu’est-ce que le courage managérial et comment le développer https://wom-recrutement.com/quest-ce-que-le-courage-managerial-et-comment-le-developper/
- [5] Le Courage Managérial : Développez cette Compétence … https://www.centraltest.fr/blog/le-courage-managerial-developpez-cette-competence-essentielle
- [6] [PDF] Les perceptions d’un leadership bienveillant dans les contextes de … https://www.strategie-aims.com/conferences/36-xxxiii-conference-de-l-aims/communications/6294-les-perceptions-dun-leadership-bienveillant-dans-les-contextes-de-mobilite-et-de-despatialisation-hybride-des-lieux-de-travail/download
- [7] Le courage en management : oser être, dire et agir ? https://theconversation.com/le-courage-en-management-oser-etre-dire-et-agir-230813
- [8] Courage managérial : tout comprendre https://www.spayr.eu/blog/quest-ce-que-le-courage-managerial
- [9] 8 conseils pour booster votre courage managérial https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/management-conseils-courage-managerial
- [10] Fait preuve de courage managérial ; manage avec … https://www.diese.gouv.fr/competences-manageriales/cadre-de-direction/relation/fait-preuve-de-courage-managerial-manage-avec
- [11] En management, la bienveillance ça va dans les deux sens https://www.innovationmanageriale.com/en-management-la-bienveillance-ca-va-dans-les-deux-sens/
- [12] Comment mettre en place un management bienveillant dans … https://bigmedia.bpifrance.fr/nos-dossiers/comment-mettre-en-place-un-management-bienveillant-dans-votre-equipe
- [13] En management, la bienveillance ça va dans les deux sens – Forbes.fr https://www.forbes.fr/management/en-management-la-bienveillance-ca-va-dans-les-deux-sens/
- [14] Happy Work – Management bienveillant et courage … https://www.youtube.com/watch?v=kzPHKdHhocs
- [15] Le leader du futur sera-t-il forcément autoritaire ? – The Conversation https://theconversation.com/le-leader-du-futur-sera-t-il-forcement-autoritaire-251381
- [16] Ne pas confondre autorité et autoritarisme en management https://www.inspirations-management.fr/courage-managerial-arretait-confondre-autorite-autoritarisme/
- [17] Fait preuve de courage managérial ; manage avec bienveillance et … https://www.diese.gouv.fr/competences-manageriales/cadre-superieur/relation/fait-preuve-de-courage-managerial-manage-avec-0
- [18] Leadership authentique : quand humilité et lucidité font la différence https://www.hbrfrance.fr/management/leadership-authentique-quand-humilite-et-lucidite-font-la-difference-60814
- [19] [PDF] adopter le leadership par la bienveillance – Montréal – Archipel UQAM https://archipel.uqam.ca/16878/1/M17947.pdf